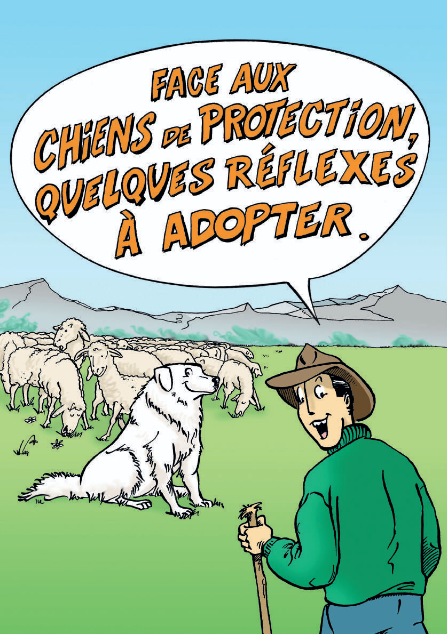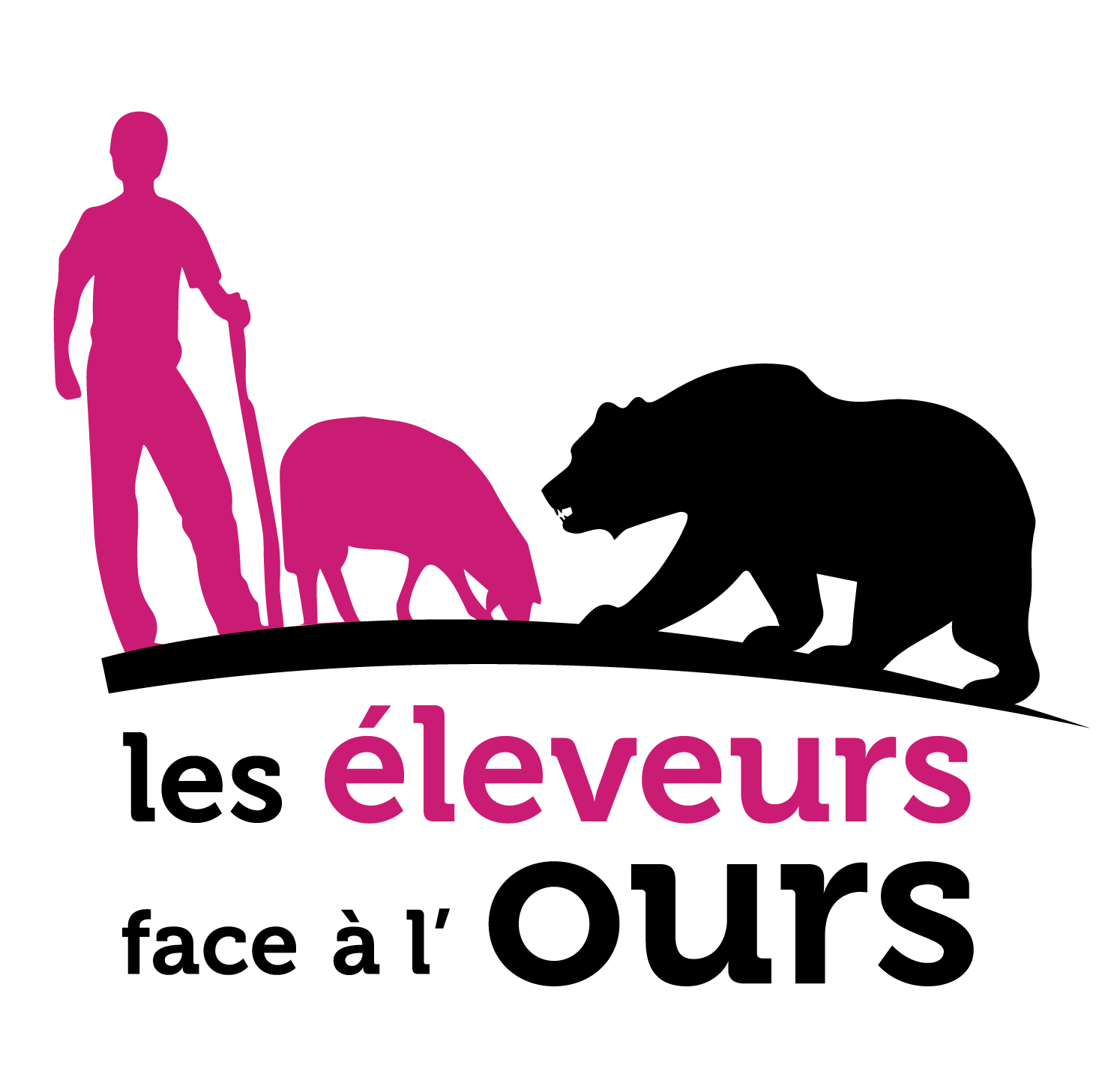Un équilibre menacé par l’expansion des grands prédateurs
L’équilibre fragile entre l’Homme, ses troupeaux et la nature est aujourd’hui profondément déstabilisé par le retour des grands prédateurs. Tout a commencé dans les années 1980 avec le retour du lynx dans le nord des Alpes, suivi dans les années 1990 par le loup, revenu naturellement dans le parc du Mercantour, et par la réintroduction de l’ours dans les Pyrénées. Plus récemment, des attaques de vautours sur des animaux vivants ont été observées, alors que ces oiseaux étaient jusqu’alors considérés comme exclusivement nécrophages.
Aujourd’hui, la France abrite plus de 1 000 loups, environ 150 lynx et plus de 90 ours. Chaque année, plus de 10 000 animaux d’élevage sont tués ou gravement blessés par ces prédateurs. Entre 2007 et 2018, la pression de prédation (attaques et dégâts) a été multipliée par 3 à 4. Elle touche en priorité les troupeaux de brebis, qui représentent 88 % des victimes.